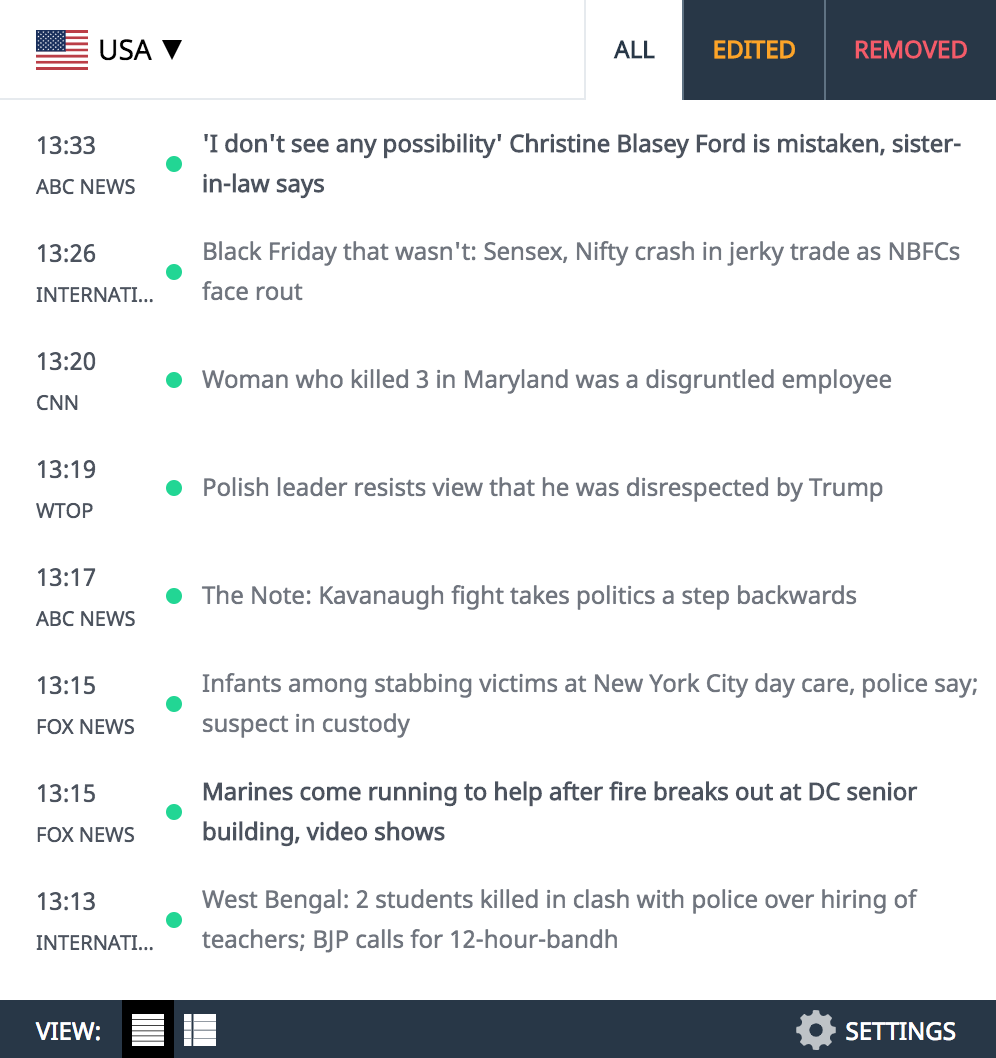Temps de lecture: 6 min
Avant l'appel du 18 juin 1940, il y a eu la pelle du 18 juin 1815 –celle que ramasse Napoléon Ier à quelques encablures de Bruxelles, dans la plaine de Waterloo. Battu une première fois en 1814, l'empereur avait pourtant réussi un retour éclatant en 1815 au gré des fameux Cent-Jours, ce «vol de l'Aigle» qui vit Napoléon chasser Louis XVIII et retrouver son trône tambour battant.
Mais voilà: au beau milieu du congrès de Vienne, censé définir un nouvel équilibre européen, les grandes puissances du continent n'apprécient que très moyennement le retour aux affaires de celui qu'elles accusent d'ensanglanter l'Europe entière depuis quinze ans. Mêmes causes, mêmes effets: le come-back impérial déclenche une nouvelle coalition (la septième, tout de même). Ce sera la bonne.
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article!
Je m'abonne
Pourquoi Waterloo? Parce que Napoléon n'a guère le choix: il doit foncer. Pour empêcher la jonction des deux principales armées qui l'attendent, l'anglaise et la prussienne, l'empereur compte prendre Bruxelles à l'arrachée, comme aux meilleures heures d'un règne marqué par les victoires fulgurantes qui ont fait sa légende.
Après une série de batailles gagnées dans la semaine qui précède le 18 juin, Waterloo fait figure de site idéal pour une victoire décisive. «L'affaire d'un déjeuner», plastronne Napoléon, qui se voit manger toute crue l'armée anglaise commandée par le duc de Wellington, encore coupée de son allié prussien. Bon, on ne risque pas de spoiler grand monde: sans dire que c'est un échec, ça n'a pas marché.
C'est bien plus qu'un échec, en réalité, c'est la (seconde) fin de l'aventure pour Napoléon, qui abdique pour de bon quatre jours plus tard avant de se faire expédier au fin fond de l'Atlantique, sur la petite île de Sainte-Hélène.
C'est surtout celle d'un certain désordre continental: de 1815 à 1914, l'équilibre européen qui découle de la défaite impériale tient vaille que vaille, avec une remarquable absence de guerre majeure sur un continent qui avait connu sa part de massacres depuis quelques siècles. Et des frontières à peu près stables.
Oh chouette, plein de cadavres
Mais revenons à Waterloo. Au soir du 18 juin, 10.000 cadavres jonchent le champ de bataille au terme d'un affrontement d'une petite journée à peine et de combats dont la violence ahurissante a marqué les esprits –la faute à des armes nouvelles comme le shrapnel anglais, une cochonnerie d'obus bourré de billes d'acier qui explosent au-dessus des combattants.
Bref, Waterloo a été une boucherie. Pour le plus grand bonheur des dentistes et de leurs patients.
Dit comme ça, évidemment, ça pique un peu, mais rien n'est plus vrai. Pour comprendre pourquoi, un bref détour par l'histoire joyeuse de la dentisterie s'impose. Si chacun s'accordera à dire qu'il vaut mieux choper une rage de dents à l'époque bénie des anesthésies sans douleur, l'art et la manière d'extraire les vieilles ratiches n'est pas de la première jeunesse: on a retrouvé au Pakistan des traces de soins dentaires qui datent du Néolithique.
Toutes ces dents n'attendent rien d'autre que la visite de jeunes entrepreneurs dynamiques, bien conscients que ça peut rapporter gros.
Au siècle de Napoléon, on n'a pas progressé tant que ça pour ce qui est de la douleur, mais on a quelque peu avancé sur tout ce qui relève des prothèses –même si ça reste, disons... artisanal. Artisanal, mais cher, soit dit en passant. La plupart des gens qui ont perdu leurs dents pour une raison quelconque font donc avec et bouffent de la soupe pour le restant de leurs jours. Pour ceux qui ont les moyens, la situation est un peu différente: perdre ses dents n'est pas si grave, tant qu'on peut profiter de celles des autres.
La technique n'est pas nouvelle –on la repère déjà en Égypte, en Grèce ou chez les Étrusques–, mais disons que l'ère préindustrielle ouvre quelques perspectives. Au XVIIIe siècle, le chirurgien anglais John Hunter théorise un peu tout ça et s'offre même une réclame du feu de Dieu, à coups d'affiches sur lesquelles il annonce acheter leurs dents fraîches à des gens. Des gens vivants.
Eh oui, pour des individus pauvres et souvent jeunes, se faire quelques sous en acceptant de se faire arracher des dents saines est un moyen comme un autre de traverser une mauvaise passe. Et tant pis si les dents en question finissent ensuite dans la bouche d'un bourgeois, enfoncées dans ses gencives ou insérées dans des prothèses toutes plus effrayantes les unes que les autres.
George Washington, l'un des pères fondateurs des États-Unis, était d'ailleurs connu pour ses abominables dentiers, qui associaient joyeusement de fausses ratiches taillées dans de l'ivoire d'hippopotame et des dents humaines. Son livre de comptes montre qu'il avait par exemple acheté neuf dents d'esclaves en 1784, pour la modique somme de 122 shillings.
Ce genre de trafic, qui continue au XIXe siècle, a d'ailleurs été immortalisé par Victor Hugo au travers du personnage de Fantine, la maman de Cosette dans Les Misérables. Sa lente déchéance passe entre autres par la vente de deux de ses incisives, qu'elle se fait arracher pour 40 francs, croyant sa fille malade: «Elle montrait deux napoléons qui brillaient sur la table. […] En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir dans la bouche.»
Peu ou prou 320.000 dents
Au soir de la bataille de Waterloo, une simple multiplication de niveau primaire permet de réaliser qu'à raison de trente-deux dents par tête de pipe, ce sont quelque 320.000 dents qui traînent sur le champ de bataille –un peu moins, si on prend en compte les malheureux qui se sont pris une balle ou un boulet dans les gencives.
Toutes ces dents n'attendent rien d'autre que la visite de jeunes entrepreneurs dynamiques, bien conscients que ça peut leur rapporter gros. Évidemment, ça n'est pas ragoûtant, mais la mise de fond est assez minime: une paire de solides tenailles, un grand sac, un pied de biche pour débloquer les mâchoires un peu coincées par la rigor mortis.
Il n'y a littéralement qu'à se baisser pour ramasser les dents de soldats qui ont l'avantage d'être souvent morts à la fleur de l'âge, donc avec des quenottes plus saines que celles d'autres sources d'approvisionnement comme les cimetières –on vous passe les détails, mais disons que le métier de profanateur de sépulture mériterait un autre article à lui tout seul.
Le business de la dent de cadavre s'est tassé lorsque les pays occidentaux ont commencé à encadrer le trafic de restes humains.
Cette manne inespérée fait que les «Waterloo teeth» inondent le marché européen de la dentisterie pendant des décennies –on en vendait encore au milieu du XIXe siècle. D'autant qu'elles ont un solide avantage sur les autres: elles se présentent souvent par lot entier. Cela permet aux artisans de bricoler des dentiers cohérents, avec une mâchoire inférieure qui s'adapte parfaitement à la supérieure, pour la bonne raison que les deux rendaient naguère de sacrés services à un seul et même soldat. Pas de frottements, pas de grincements, pas de douleur aux gencives –un atout non négligeable sur le marché de la ratiche d'occasion.
Une fois les dents récupérées, il ne restait plus qu'à les vendre aux ancêtres des prothésistes dentaires et des chirurgiens-dentistes, qui les faisaient bouillir pour bien en enlever les petits bouts de viande restants, avant d'en scier les racines, puis de les monter sur des bridges complets. Il suffisait ensuite de les écouler sur le marché anglais ou américain, sans toujours prendre la peine de préciser aux clients d'où venaient leurs jolis râteliers tout neufs. Les prix explosent, la demande aussi et ce n'est bientôt que joie, bonheur, profit et mastication.
Le business de la dent de cadavre s'est tassé lorsque les pays occidentaux ont commencé à encadrer le trafic de restes humains, avec des textes comme l'Anatomy Act anglais de 1832. Mais surtout, de nouveaux produits sont arrivés vers 1830. On commence à fabriquer des prothèses dentaires en porcelaine, une innovation qu'on doit (encore) à un Anglais, Claudius Ash, avant que l'Américain Charles Goodyear ne calme tout le monde en inventant la vulcanisation du caoutchouc. Charles Goodyear ne tire pas que des pneus de cette découverte: il en fait LE support de base de la dentisterie dans sa version rose vif –idéal pour un minimum de discrétion esthétique.
Petit à petit, le secteur marchand fera le reste et on commencera à trouver de plus en plus chelou la récupération des dents de morts, d'autant que la vulcanite irrite nettement moins le palais que les anciennes montures en ivoire. De quoi croquer la vie à pleines dents.